Milan Kundera – Une rencontre
 Résumé :
Résumé :
Milan Kundera nous propose ici des “rencontres”, une trentaine qu’il résume ainsi au début du livre : “… rencontre de mes réflexions et de mes souvenirs ; de mes vieux thèmes (existentiels et esthétiques) et mes vieux amours (Rabelais, Janacek, Fellini, Malaparte…)…”
Extrait :
“Oh, j’ai vu bien des agonies… ici… là… partout… mais de loin pas des si belles, discrètes… fidèles… ce qui nuit dans l’agonie des hommes c’est le tralala… l’homme est toujours quand même en scène… le plus simple”
“Ce qui nuit dans l’agonie des hommes c’est le tralala.” Quelle phrase ! Et : “l’homme est toujours quand même en scène”… Qui ne se rappelle la comédie macabre des célèbres “dernières paroles” prononcées sur le lit de mort ? C’est ainsi : même râlant, l’homme est toujours en scène. Et même “le plus simple”, le moins exhibitionniste, car il n’est pas toujours vrai que l’homme se met lui-même en scène. S’il ne s’y met pas lui-même, on l’y met. C’est son sort d’homme.
Et le “tralala” ! La mort toujours vécue comme quelque chose d’héroïque, comme le finale d’une pièce, comme la conclusion d’un combat. Je lis dans un journal : dans une ville, on lâche des milliers de ballons rouges en hommage aux malades et aux morts du sida ! Je m’arrête sur ce “en hommage”. En mémoire, en souvenir, en signe de tristesse et de compassion, oui, je comprendrais. Mais en hommage ? Y a-t-il quelque chose à célébrer, à admirer dans une maladie ? La maladie est-elle un mérite ? Mais c’est ainsi, et Céline le savait : “ce qui nuit dans l’agonie des hommes c’est le tralala”.
Beaucoup de grands écrivains de la génération de Céline ont connu comme lui l’expérience de la mort, de la guerre, de la terreur, des supplices, du bannissement. Mais ces expériences terribles, ils les ont vécues de l’autre côté de la frontière : du côté des justes, des futurs vainqueurs ou des victimes auréolées d’une injustice subie, bref, du côté de la gloire. Le “tralala”, cette autosatisfaction qui veut se faire voir, était si naturellement présent dans tout leur comportement qu’ils ne pouvaient pas l’apercevoir ni le juger. Mais Céline s’est trouvé pendant vingt ans parmi les condamnés et les méprisés, dans la poubelle de l’Histoire, coupable parmi les coupables. Tous autour de lui ont été réduits au silence : il a été le seul à donner une voix à cette expérience exceptionnelle : l’expérience d’une vie à laquelle on a entièrement confisqué le tralala.
Cette expérience lui a permis de voir la vanité non pas comme un vice mais comme une qualité consubstantielle à l’homme, qui ne le quitte jamais, même pas au moment de l’agonie ; et, sur le fond de cet indéracinable tralala humain, elle lui a permis de voir la beauté sublime de la mort d’une chienne.
(à propos de D’un château l’autre, de Louis-Ferdinand Céline)
Avis :
Kundera est un écrivain que j’adore. J’ai peu parlé de ses livres sur ce site, les ayant lu avant la création d’Artsouilleurs mais il faudra quand même que je relise ses romans ou que je lise tout simplement certains autres que je n’ai pas encore pris le temps de découvrir. Bref, dès que j’ai appris (un peu tardivement) que Kundera sortait un nouveau livre, j’ai voulu le lire. Il s’agit ici d’un essai, donc bien différent des Kundera que j’ai pu lire pour le moment (n’ayant pas encore lu “Le rideau” ni “L’art du roman“). J’ai néanmoins retrouvé ici le Kundera qui ne va jamais dans la demi-mesure et qui nous donne son opinion sans hésitations. S’il le fait déjà dans ses romans, l’essai s’y prêtant encore plus, il en profite ! Des thèmes très variés sont abordés ici dont certains qui lui sont chers comme l’oubli, la musique et bien sûr l’art du roman. Je n’ai pas apprécié toutes les “rencontres” qui sont regroupées ici. J’ai adoré la première moitié du livre, que j’ai trouvée très intéressante (à l’image de l’extrait ci-dessus). La seconde moitié a été plus difficile. Je crois surtout que je manquais de connaissances poussées en littérature ou sur certains personnages pour pouvoir en apprécier pleinement la lecture. D’un point de vue plus global c’est un livre que j’ai apprécié et qui m’a appris beaucoup mais, de Kundera, j’aurais plutôt tendance à vous orienter vers ses romans (“L’insoutenable légèreté de l’être”, “L’ignorance” …) plutôt que vers celui-ci à réserver à un public ayant un très fort penchant littéraire.
Note : ![]()
Milan Kundera (1929) – Français d’origine tchèque
204 pages – 2009 – ISBN : 978-2-07-012284-4
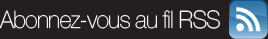













juin 4th, 2009 à 8:11
J’en ai parlé il y a quelques jours sur mon blog, justement.
J’aime énormément cet auteur … pour ne pas dire que c’est mon préféré.
juin 4th, 2009 à 8:53
Et j’ai commenté il y a quelques heures sur ton blog, justement
Je me souviens que tu avais déjà mis un commentaire sur l’article que j’avais fait à son sujet. Pour moi aussi c’est l’un des auteurs que je préfère !
septembre 4th, 2009 à 13:30
Ce fut pour moi aussi une lecture très plaisante, même si j’ai été plus sensible à “L’art du roman”, mais c’est aussi parce que je connaissais un peu plus les œuvres que Kundera y évoquait.
“Une rencontre” est un essai très libre sur diverses œuvres d’art qui ont marqué Kundera ; le problème, c’est que la plupart nous sont parfaitement inconnues. Il réussit pourtant à les faire vivre sous nos yeux, à nous donner envie de les lire (c’est plus difficile quand il s’agit de musique car là, il ne peut aller contre l’absence de notions musicales et l’ignorance du lecteur). Le livre a aussi un côté autobiographique discret en même temps qu’il nous fait profiter à nouveau de la conception très affinée de Kundera sur le roman.
On rêverait que plus d’auteurs réfléchissent ainsi sur ce genre et rendent comme Kundera l’essai plus lisible. En outre, de par ses origines tchèques, il a un regard différent de celui que pourrait porter un Français sur les œuvres évoquées.
Je ne peux pourtant pas m’empêcher parfois de me demander si ce n’est pas profiter d’une certaine facilité de parler d’œuvres que le lecteur connaît peu ou pas, parce que l’analyse tranchée et brève qui en est faite ampute forcément les livres de leur densité… Mais ce n’est pas un grief que je retiendrai contre Kundera dont la lecture continue de m’enchanter.
Et puis, ce livre a quelque chose de touchant, cette manière de rassembler ce qu’on aime de manière assez informelle (comme il l’a fait dans ses précédents essais) constitue une précieuse anthologie littéraire nourrie des goûts de Kundera, presque un matériau autobiographique qui vient éclairer l’image que nous renvoient ses romans).
J’ai envie de finir en citant un passage que j’ai beaucoup aimé :
“Dans notre temps on a appris à soumettre l’amitié à ce qu’on appelle les convictions. Et même avec la fierté d’une rectitude morale. Il faut en effet une grande maturité pour comprendre que l’opinion que nous défendons n’est que notre hypothèse préférée, nécessairement imparfaite, probablement transitoire, que seuls les très-bornés peuvent faire passer pour une certitude ou une vérité. Contrairement à la puérile fidélité à une conviction, la fidélité à un ami est une vertu, peut-être la seule, la dernière.”
novembre 27th, 2009 à 23:33
[...] moment que je ne m’étais pas plongé dans les lignes de Milan Kundera (à part pour “Une rencontre“ qui est un essai et donc d’un style très différent). Les romans de Kundera sont [...]